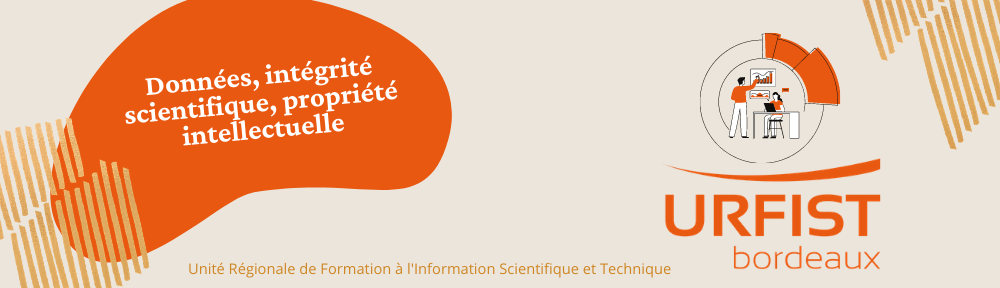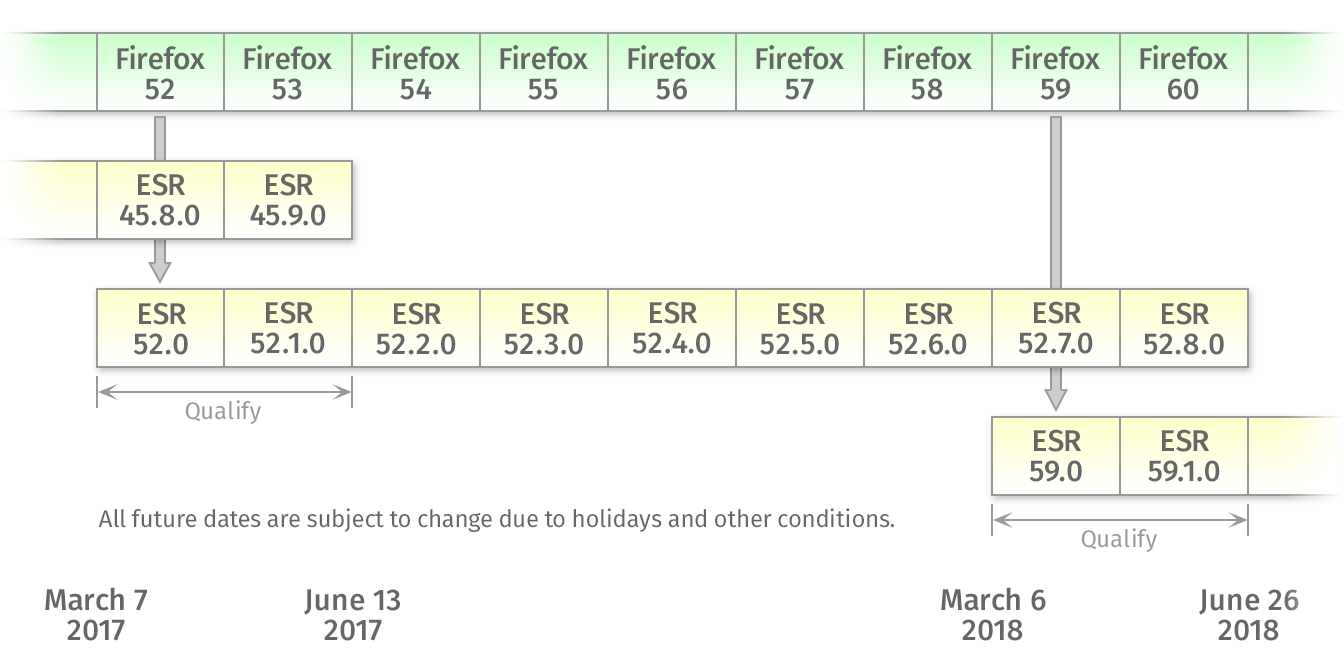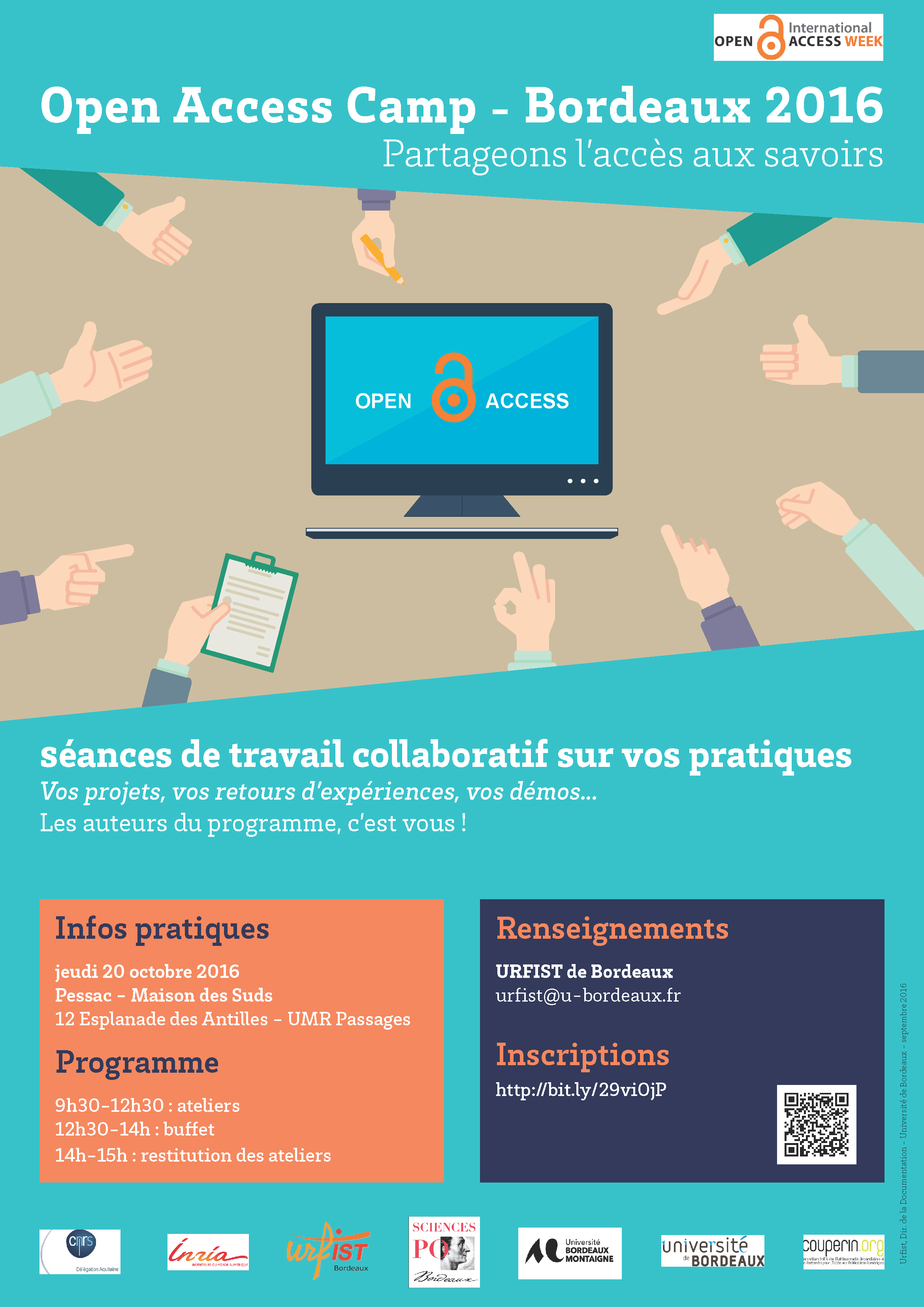Argumentaire
La gestion de ses données présente un enjeu majeur en termes de visibilité et de rayonnement de ses recherches. Il s’agit de pouvoir exploiter les données produites, les préserver mais aussi les réutiliser et faciliter de nouvelles recherches. Ainsi, bien documenter ses données est devenu une étape incontournable du montage de projet et ces données peuvent par la suite être valorisées par leurs auteurs ou d’autres chercheurs via des data papers, le dépôt des données dans des entrepôts dédiés.
À l’heure de la remise en question des processus de validation des travaux, la gestion des données de recherche intervient aussi comme un outil de contrôle de qualité au service des chercheurs. Si la tâche peut sembler chronophage, elle constitue néanmoins un retour sur investissement considérable pour une équipe. Elle s’inscrit également dans une démarche de « science ouverte » qui contribue à renforcer la place de la science dans la société.
De quoi parle-t-on lorsqu’on parle de « données » ? Quels sont les enjeux de la gestion des données pour la recherche ? Quelles sont les conséquences de cette gestion pour les publiants? Quels sont les impacts sur les processus de l’édition scientifique (data papers, nécessité de rendre les données citables ; normes pour citer les données? Quels sont les enjeux transverses? (technique, juridique, éthique, etc.) ? Quelles sont les étapes et les bonnes pratiques à suivre pour le montage d’un projet, puis en cours de projet et à son issue ? Quels sont les enjeux juridiques liés ?
Programme
Consulter les vidéos de la journée
9h00-9h30 : Accueil participants
9h30-9h45 : Présentation du réseau Renatis par Ariane Rolland et Romain Vanel
9h45-10h15 : « Les données primaires dans la recherche : introduction et enjeux », Frédérique Flamerie, conservateur des bibliothèques à l’Université de Bordeaux
Télécharger la bibliographie au format .bib pour un import facilité dans votre outil de gestion de références biblios
Qu’elles soient big, small, dark ou open, les data prennent une place centrale dans les processus de financement et de publication de la recherche, avec des impacts tant individuels que collectifs, tant techniques que scientifiques et éthiques.
Nous tenterons ainsi de caractériser cet objet divers et protéiforme qu’est la donnée de recherche, pour appréhender les multiples enjeux auxquels elle confronte la communauté scientifique au sens large. Enfin, nous dégagerons quelques perspectives à la fois concrètes et politiques à partir d’exemples français et internationaux.
10h15-10h30 Questions avec le public
10h30-11h : « Les données au cœur des projets de recherche », Christine Mahodaux, responsable du Service Partenariat et Valorisation de la délégation Aquitaine du CNRS
Quelles bonnes pratiques pour le montage de dossier? Quelles étapes? Situation France/international (projets ANR/H2020…) ». Gérer des données de recherche fait partie intégrante du projet de recherche. La gestion des données de recherche requiert une organisation, une planification, et un suivi rigoureux tout au long de la vie de projet et au-delà pour assurer la pérennité, l’accessibilité et la réutilisation de ces données.
Thèmes abordés : La prise en compte de la gestion des données dans le cadre du montage de projet ; La propriété et la protection des données ; Les bonnes pratiques ( cahier de laboratoire, conservation et archivage, diffusion etc..) ; Les préconisations en fonction des financeurs
11h-11h15 : Questions avec le public
11h15-11h35 : Pause
11h35-12h : « L’ouverture des données de la recherche : quelles conséquences juridiques pour le chercheur? », Hélène Skrzypniak, maître de conférences en droit privé à l’URFIST, membre de l’IRDAP
Ces dernières années, les textes destinés à promouvoir l’ouverture des données de la recherche se sont multipliés, tant au niveau international que national. Le mouvement est aujourd’hui désigné sous les termes d’open access. Il vise, notamment, à encourager la publication en libre accès des publications scientifiques. La France n’a pas été épargnée par ce mouvement comme en atteste l’adoption récente de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 dont plusieurs dispositions visent à favoriser l’ouverture des données de la recherche.
Ces différents textes créent ainsi des nouvelles obligations pour le chercheur mais aussi de nouveaux droits. Dans ce contexte, nous proposons de revenir sur le cadre juridique de l’ouverture des données de la recherche : quelles sont les données concernées ? Quelles conditions doivent être respectées ? L’ouverture des données est-elle une obligation pour le chercheur ? Quelle protection pour le chercheur qui ouvre ses données ?
12h-14h : Buffet sur place
14h-14h30 : « Retour d’expérience : Mise en place de plans de gestion au centre de calcul de l’in2p3 et applications », Pascal Calvat, Informaticien à IN2P3
Le centre de calcul de l’in2p3 souhaite mettre en place un plan de gestion de données pour l’ensemble de ses 2500 utilisateurs sur une période de deux ans. Une fois collectées, les politiques des plans de gestion devraient être mises en œuvre au travers d’une application informatique en cours de prototypage.
14h30-15h : « Retour d’expérience : Projet d’archivage à long terme pour les données 3D archéologiques », Sarah Tournon-Valiente, UMS Archéovision à Bordeaux
Les projets de recherche en SHS et plus particulièrement en archéologie n’hésitent plus à intégrer des données 3D. Que faire de ces données 3D de plus en plus volumineuses ? Comment les stocker , les pérenniser ?
Le laboratoire Archeovision avec sa cellule de transfert Archeotransfert, grand producteur de données 3D pour les SHS s’est rapidement préoccupé de ces questions, créant le premier conservatoire 3D en SHS. Aujourd’hui, le projet d’archivage mené par Archéovision au sein du consortium 3D d’Huma-Num vient compléter ce premier dispositif.
15h-15h15 : Pause
15h15-16h : Table ronde avec les intervenants de la journée, animée par Julien Baudry, conservateur de bibliothèque à l’Université Bordeaux Montaigne