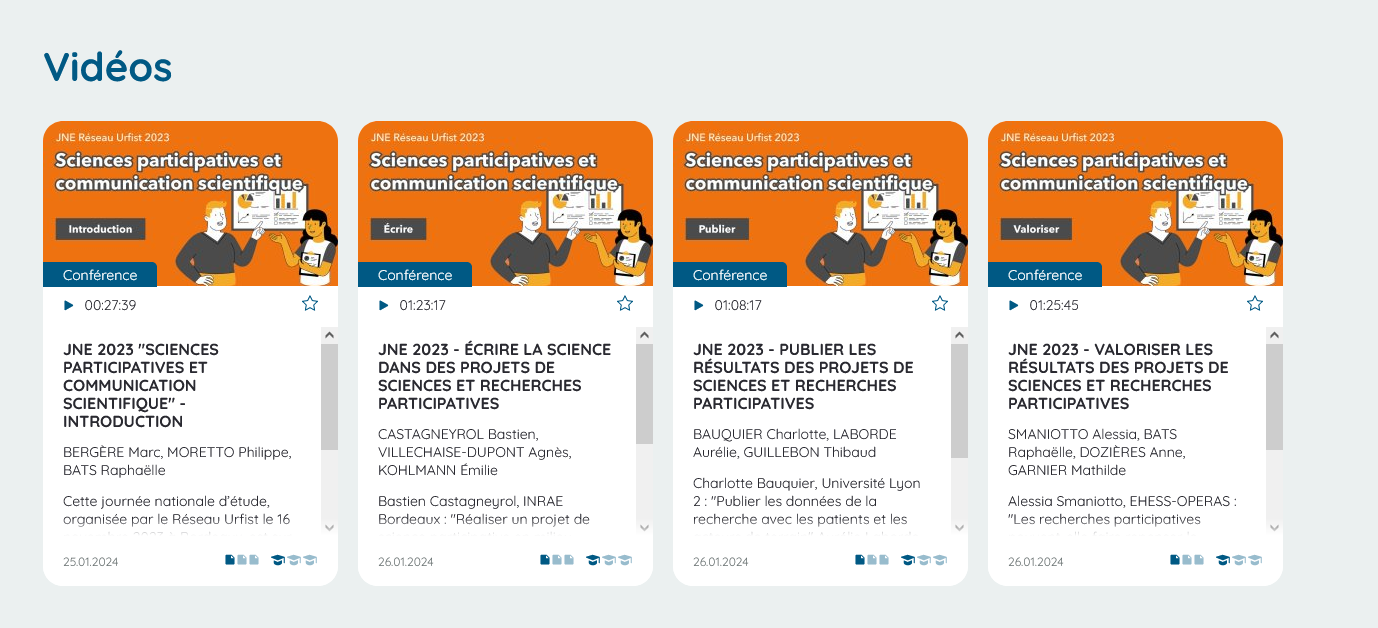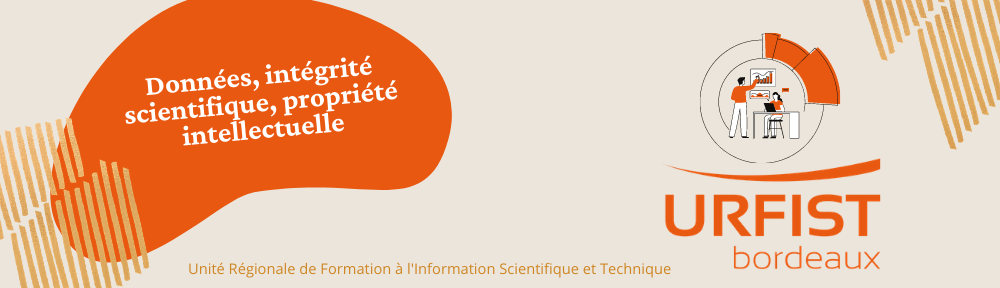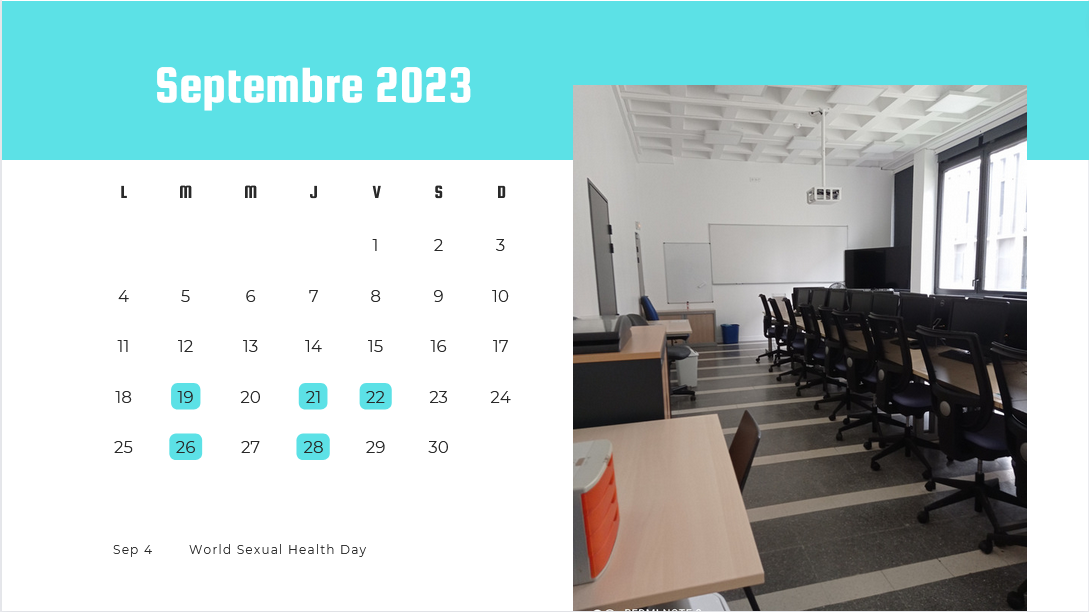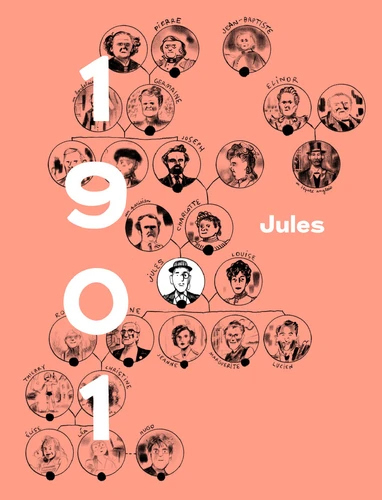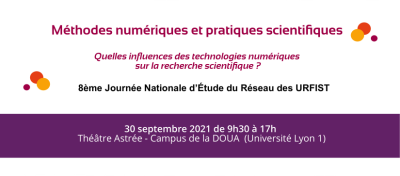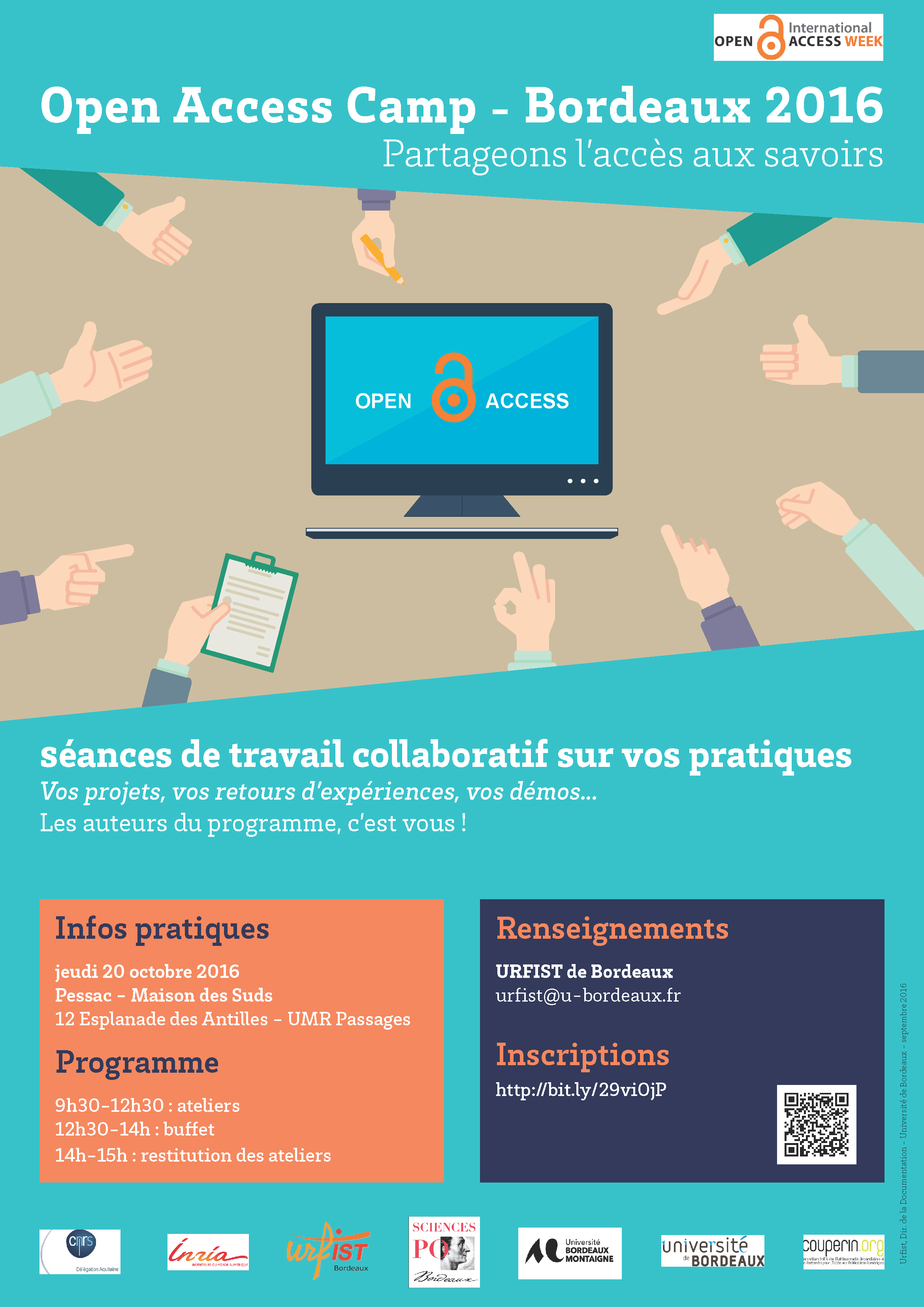Argumentaire
Alors que depuis plusieurs décennies, des outils spécialement conçus pour la diffusion des travaux de recherche sont proposés aux chercheurs, force est de constater la rapidité avec laquelle les auteurs se sont emparés des réseaux sociaux, généralistes comme spécialisés, pour accroître la visibilité de leur production. La facilité d’utilisation fait partie des arguments les plus fréquemment évoqués pour justifier le recours aux réseaux sociaux par un public académique. Mais l’utilisation de tels outils n’est pas réductible à la seule question de l’ergonomie et des fonctionnalités proposées. En effet, le recours aux réseaux sociaux a des impacts profonds sur les modalités de communication entre chercheurs et sur la manière de partager leurs travaux. L’engouement des chercheurs pour les réseaux sociaux n’est pas neutre et soulève la question de l’identité numérique de l’auteur.
Par ailleurs, si les réseaux sociaux représentent des outils conçus pour mettre en relation des individualités, se pose aussi la question du positionnement des organismes de recherche. Comment les chercheurs s’approprient-ils ces outils conçus pour faciliter la découverte et la collaboration ? Voit-on les communautés scientifiques se reconstituer à l’identique? Les réseaux sociaux permettent-ils de se retrouver plus facilement entre pairs ou favorisent-ils un décloisonnement des spécialités? Quels sont les usages des chercheurs des fonctionnalités dites »sociales »? Quels sont les mécanismes de légitimation des experts? Dans quelle mesure les réseaux sociaux modifient-ils la notion d’identité numérique des chercheurs? Quelles dynamiques identitaires voient-on émerger sur les réseaux sociaux lorsqu’il s’agit d’un public scientifique?

La matinée d’étude est co-organisée par l’Université de Limoges (direction de la recherche et service commun de la documentation) et l’Urfist de Bordeaux. La matinée n’est pas filmée.
Programme
– 9h-9h20 : accueil des participants, remise des documents
– 9h20-9h30 : allocution de bienvenue, ouverture de la matinée par Claire Corbel, directrice du pôle Recherche de l’Université de Limoges
– 9h30-10h : « Réseaux sociaux et recherche : enjeux pour les chercheurs », par Sabrina Granger, conservateur des bibliothèques responsable de l’Urfist de Bordeaux
– 10h-10h30 : Retours d’expérience de chercheurs de l’Université de Limoges : , Irène Langlet est professeure de littérature contemporaine et spécialiste de la science-fiction, de la littérature non-fictionnelle et des genres médiatiques contemporains, rédactrice en chef de la revue Res Futurae.
Elsa Thune est maitre de conférences à l’ENSCI (École nationale supérieure de céramique industrielle), membre du laboratoire SPCTS (Science des procédés céramiques et des traitements de surface).
– 10h50-11h20 : « Le chercheur dans les réseaux de la République digitale : présence, communautés et nouvelles publications », par Olivier Le Deuff, enseignant-chercheur à l’Université Bordeaux Montaigne. Les travaux d’O. Le Deuff portent entre autres sur l’analyse des évolutions communicationnelles et informationnelles liées aux environnements numériques.
– 11h20-12h10 : « Usage des réseaux sociaux par les organismes de recherche : état des lieux et évolutions 2012 – 2014″, par Mathieu Jahnich, fondateur du Sircome . Depuis 2012, Sircome réalise une étude annuelle de l’usage des réseaux sociaux par les organismes français de recherche : ANDRA, ANRS, ANSES, BRGM, CEA, CIRAD, CNES, CNRS, FCBA, IFPEN, IFREMER, IFSTTAR, IGN, INED, INERIS, INRA, INRAP, INRIA, INRS, INSERM, Institut Cancer, Institut Curie, Institut Pasteur, IPEV, IRD, IRSN, IRSTEA, MNHN, ONEMA, ONERA.
– 12h10-12h20 : « Rendre plus visible la recherche », par Diane Daian, responsable du service communication de l’Université de Limoges
– 12h20-12h30 : conclusion
Consulter le compte-rendu rédigé par le Sircome
Infos pratiques :
http://bit.ly/23DAMbA http://www.fdse.unilim.fr/article13.html http://www.tourismelimousin.com/A-voir/Villes-villages-et-patrimoine/fre-FR/Faculte-de-Droit
Hôtel de la Bastide, 32 rue Turgot, Limoges